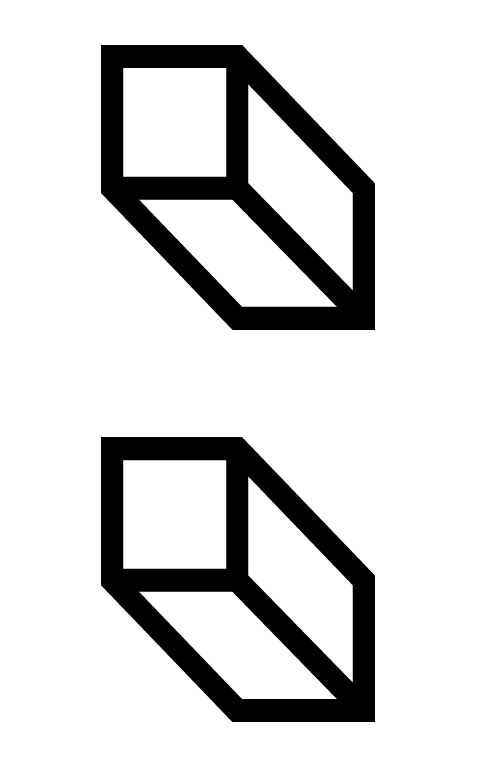La Fabrique d’expériences

Présentation
Retours d'expériences
Venez partager vos impressions et questionnements de spectateurs avec les chercheurs de l’Institut Convergences Migrations et la metteure en scène, Myriam Marzouki.
Découvrez l'Institut Convergences Migrations
+ d'infos
Trois questions à Olga Gonzalez
Olga L. Gonzalez, vous êtes sociologue et travaillez notamment sur les facteurs socioculturels et migratoires qui entourent la prévention du VIH auprès des personnes trans MtF latino-américaines. Pouvez-vous nous en dire plus ?
Je dirais, pour commencer, que la figure des personnes trans d’Amérique latine est intégrée dans le paysage sinon français, du moins parisien. Les médias ont bien fait connaître, parfois mal connaître d’ailleurs, la présence des femmes trans d’Amérique latine, notamment au Bois de Boulogne. Ce que les Français ne savent peut-être pas, c’est que ces figures, c'est à dire les femmes trans qui exercent le travail sexuel, sont très présentes en Amérique latine. Dans de nombreuses villes existent ces figures, des personnes nées hommes, qui se transforment en femmes, plus précisément qui vivent en tant que femmes, et qui souvent sont dans les secteurs marginaux et notamment dans la prostitution. Ces personnes, exotiques en France, font pour ainsi dire partie de la culture urbaine populaire en Amérique latine, elles font partie de la nuit. Elles sont évoquées dans des séries ou dans des chansons, elles ne sont pas aussi exotiques qu’ici.
Mon travail de recherche comporte plusieurs volets, l’un d’eux se réfère à leur vulnérabilité par rapport au VIH. Comme je le disais, en raison d’une multitude de facteurs, ces personnes sont reléguées à certains secteurs d’activité spécifiques. Elles subissent beaucoup de violences et ont une connaissance de la marginalité, et la somme de ces facteurs font qu’elles ont une grande vulnérabilité par rapport au VIH. Mon travail s’efforce également de comprendre quelles sont les conditions sociales et culturelles qui les ont amenées à adopter la transidentité. Cela suppose de bien connaître leurs trajectoires individuelles et leurs milieux d’origine. Enfin, je m’intéresse également à leurs trajectoires de vie dans l’émigration : dans ce milieu, la migration fait partie de la vie depuis le jeune âge, d’abord la migration vers la ville, puis vers la grande ville, et quand on a les moyens, vers l’étranger.
En quoi l’approche sensible et notamment le théâtre peuvent-ils être des outils à votre recherche ?
Les questions contemporaines peuvent être travaillées artistiquement. Le théâtre est un formidable outil pour donner une voix vivante à notre société, laquelle se caractérise par sa diversité.
Par exemple, le théâtre s’est emparé des questions LGBT, ces questions sont de plus en plus visibles. Je pense que cette visibilité est une bonne chose. Comme vous le savez sans doute, le thème des « minorités sexuelles », comme on les appelle parfois, a été abordé au dernier Festival d’Avignon. J’ai eu l’occasion de voir certaines des pièces issues de ce répertoire, ce qui m’a le plus frappé ce sont les pièces construites à partir des témoignages des personnes. Car on a du mal, souvent, à se représenter les expériences d’autrui, on a tendance à projeter celles que l’on connaît et à imaginer que c’est partout pareil, or ce n’est pas le cas et le théâtre peut rendre compte de ces singularités. On est alors frappé de voir qu’un même sigle, ici LGBT, donne lieu à des phénomènes somme tout particuliers.
Il en est de même avec les migrations. J’ai vu peu de pièces en France avec ceux qu’en sociologie on appelle les « primo-arrivants », et qu’on a tendance à englober dans un même ensemble et qu’on voit comme des personnes particulièrement démunies. Je ne pense pas qu’on avance beaucoup en mettant ce genre de grandes étiquettes sur des personnes qui ont des expériences de vie très différentes. Une partie de mon travail consiste à montrer la singularité de ces personnes, qui sont traversés comme chacun d’entre nous par des assignations – une langue, une nationalité, un milieu social - et qui affrontent l’expérience de la migration de manière différenciée. Les migrants ne sont pas des chiffres, et je pense que le travail théâtral peut justement restituer la singularité de chacun.
Qu’attendez-vous de la rencontre autour du spectacle Que viennent les barbares, de Myriam Marzouki ?
Je ne connais pas la pièce de Myriam Marzouki, je la découvrirai le 17 mars. J’ai vu la présentation de la pièce sur la brochure et lu cette phrase : « À quelle altérité renvoie cette surface de l’apparence que nul ne choisit ? » Je pense que les questions de l’altérité vont bien au-delà des couleurs de peau. On aura certainement l’occasion d’en discuter au moment de la rencontre.