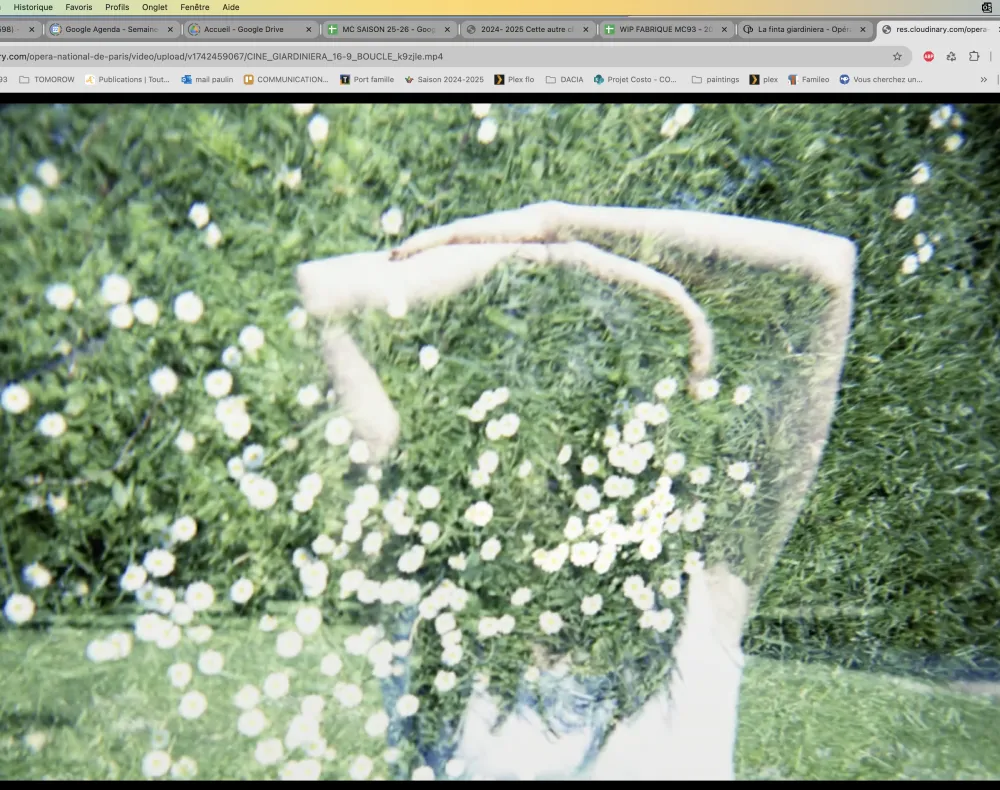Entretien avec Marine de Missolz
Entretien avec Marine de Missolz
Qu’est-ce qui a orienté votre choix vers un texte de Marguerite Duras ? Et plus particulièrement vers Le Camion qui est, à l’origine, un projet de cinéma ?
Marine de Missolz : Ce qui m’a frappée, c’est la forme, la construction, que je trouve prodigieuse et tellement provocatrice : un film qui raconte ce qu’aurait été le film s’il avait été tourné. Un film au conditionnel, qui laisse ouvert tous les possibles… Le dialogue entre Duras et Depardieu semble s’élaborer au présent, mais c’est un leurre, parce qu’en réalité, le scénario est très écrit : ils lisent.
C’est une mise en scène du processus créatif. À sa sortie, certains criaient au génie, et d’autres au « foutage de gueule ». Ces deux dimensions m’intéressent.
Duras casse les codes de la fiction et de la représentation. Elle se débarrasse de tout le superflu,
pour s’attaquer directement au cœur de ce qui se passe à l’intérieur des êtres. Je suis attirée par les tentatives de déconstruction du récit traditionnel. La forme narrative d’une histoire avec « introduction, péripéties, résolution » n’est pas ce qui me parle le plus.
Questionner avec amour, tendresse et humour les démarches expérimentales en art, les formes qui ont cherché à remettre en question la construction classique du récit.
Dans une interview datant de la sortie du film à Cannes, Duras dit que les gens ont l’habitude des choses prémâchées, prédigérées. Selon elle, le spectateur est sollicité au mieux à 20% ; elle veut inverser les choses : qu’il le soit à 80%.
M.d.M. : C’est exactement ça. Le film est issu du cinéma expérimental, qui cherchait à mobiliser beaucoup plus l’investissement du spectateur dans sa réception d’une œuvre. Ces réalisateurs cataloguaient le cinéma conventionnel de « cinéma capitaliste », qui donnait à consommer, là où ils voulaient faire un cinéma qui rende le spectateur actif en réclamant de sa part un « travail » d’imagination, de composition, d’association.
En exergue de la parution de son texte, Duras explique clairement sa démarche, elle dit du cinéma traditionnel : « Le cinéma arrête le texte, frappe de mort sa descendance : l’imaginaire. C’est là sa vertu même : de fermer. D’arrêter l’imaginaire. Cet arrêt, cette fermeture s’appelle : film. Bon ou mauvais, sublime ou exécrable, le film représente cet arrêt définitif. La fixation de la représentation une fois pour toutes et pour toujours. » Duras veut donner une dimension beaucoup plus vaste au cinéma et interpeller le spectateur à un degré plus élevé. Elle veut amener le spectateur du film à un niveau d’appropriation et de liberté aussi grand que celui du lecteur face au livre. Avec Le Camion, je trouve qu’elle a particulièrement réussi ce pari.
Le dialogue, par lequel l’histoire pas à pas s’élabore, crée une qualité de présent toute particulière. L’emploi du conditionnel parle mieux de la désillusion que ne pourrait le faire n’importe quel texte. Les silences, les incertitudes disent l’impossibilité de résoudre la question de l’humanité par un discours bien ficelé. Le Camion laisse le temps de penser dans ses creux. Et c’est une matière extrêmement vivante, animée par un dialogue parfois plus prosaïque que littéraire.
Faire Le Camion au théâtre, c’est pousser encore plus loin la provocation : raconter sur un plateau de théâtre un film qui lui-même raconte ce qu’aurait été le film s’il avait été tourné ! Ce spectacle est pour moi l’occasion de questionner avec amour, tendresse et humour les démarches expérimentales en art, les formes qui ont cherché à remettre en question la construction classique du récit.
Je n’ai aucunement envie de susciter une « messe durassienne », grave, sérieuse et péremptoire. Je veux faire entendre l’autre Duras, celle qui se marre, provoque et s’en moque.
Comment envisagez-vous la version théâtrale du texte ?
M.d.M. : Le Camion a une dimension théâtrale évidente. Tout passe par les mots. Mettre en scène ce texte au théâtre, c’est faire le pari que raconter peut être plus fort que d’incarner les situations. C’est penser que le pouvoir d’évocation des mots peut toucher plus fort et plus juste qu’un enchaînement d’actions. Ici, la construction sous forme de dialogue est tout à fait intéressante parce qu’elle engage les narrateurs beaucoup plus loin que la simple fonction de raconter une histoire.
On peut parler de personnages. Mais ce qu’il y a d’étrange, c’est que ces personnages ne font rien à proprement parler, si ce n’est penser ensemble, ou du moins essayer de penser ensemble. Si, à un ou deux moments, ils fument une cigarette ! Et pourtant à l’intérieur de cette non-action sidérante, tout ou presque apparaît de ce qui se joue dans les rapports humains. C’est l’idée de la réunion de ces trois comédiens là, Laurent Sauvage, Hervé Guilloteau et Olivier Dupuy, qui m’a donné envie de monter ce projet.
Je n’ai aucunement envie de susciter une « messe durassienne », grave, sérieuse et péremptoire. Je veux faire entendre l’autre Duras, celle qui se marre, provoque et s’en moque. Celle qui pense que « la vie est une vaste rigolade ». Je n’ai pas du tout l’intention de profaner la langue de Duras, car je pense véritablement que ce qui se dit dans chacune des phrases du texte est essentiel. Mais je veux aussi qu’on joue avec la matière, qu’on l’observe avec nos yeux à nous, auxquels il peut arriver de ressentir méfiance, défiance, rejet total de ce qui se joue. Si le plateau de théâtre est bien le lieu de la libre pensée, le postulat de l’adhésion obligatoire du comédien à ce qu’il dit n’a pas lieu d’être.
Quel sera le rapport à la langue et à l’incarnation, aux personnages ? Laurent Sauvage, par exemple, va-t-il jouer qu’il est Marguerite Duras ?
M.d.M. : Non. Laurent Sauvage prend en charge le texte que dit Duras dans le film, Hervé Guilloteau celui que dit Gérard Depardieu, et Olivier Dupuy ne prend en charge aucune partition écrite. J’ai voulu casser le huis clos du dialogue par l’intrusion de ce troisième personnage. Figure muette, il pourra éventuellement être associé à la mention de la présence d’un deuxième chauffeur du camion, qui « aurait dormi pendant tout le film ».
Il ne s’agit pas du tout, pour Laurent et Hervé, de « jouer » Duras et Depardieu. Dans le texte, il y a la figure de l’auteur, de l’artiste, du créateur, qui fait œuvre, encouragé par un témoin/complice. Nous allons partir de ces figures pour inventer des nouveaux personnages, des nouvelles situations, en toute liberté par rapport au film. Il est hors de question de lire le texte assis autour d’une table ! Nous allons développer une théâtralité entre les personnages, fabriquer des petites « scènes » sans texte qui parsèmeront le récit.
Dans le texte, la parole est très hiérarchisée : le chef de bande – la partition de Duras –, interprété par Laurent Sauvage, prend les rênes de la fiction. Le branleur – la partition de Depardieu –, interprété par Hervé Guilloteau, adhère au jeu parce qu’il n’a rien de mieux à proposer, à moitié convaincu. Et puis il y a celui qui ne prend pas la parole, figure mystérieuse, timide, sensible, interprétée par Olivier Dupuy. Je veux désacraliser l’aspect formel et poétique de la langue de Duras en mettant au cœur de la dramaturgie l’idée de cette « bande masculine ».
On pourrait se raconter une petite histoire : c’est trois hommes qui se retrouvent sur une place de village déserte, à trois heures du matin – une sortie de bistrot – et qui, par désœuvrement, se mettent à rêver ce projet de film… Avec le décalage qui existe, car l’objet du film n’est pas ce qu’on pourrait attendre d’eux a priori – de leur imaginaire supposé – et avec le frottement lié au fait que leurs mots sont de sensibilité plutôt féminine.
J’ai choisi ces acteurs parce qu’ils ont tous les trois à leur manière cette capacité d’être dans une très grande sincérité, tout en ayant en eux une forme de distance par rapport à la démarche qu’ils entreprennent, une sorte de sourire en coin. Ce texte écrit par une femme, avec une sensibilité féminine, associé à la présence de cette « bande d’hommes », crée une étrangeté, un effet d’absurde, une grande beauté et la tentation du rire mêlés.
Souhaitez-vous développer une esthétique des années 70/80, notamment dans les costumes, ou du point de vue de la musique ?
M.d.M. : Non, les costumes sont « intemporels », correspondant à des figures plus qu’à une époque. La musique est une composition originale de Matt Elliott, compositeur interprète du mouvement dark folk anglais. Il compose et joue seul, en créant des boucles de guitare et de voix. Souvent, ses morceaux commencent par de la guitare électroacoustique et une simple voix ; au fur et à mesure, il arrive à une amplification qui peuple sa musique avec des intonations qui donnent la sensation de se trouver en présence d’une grande chorale des pays de l’Est. C’est une musique sombre et mélodramatique, qui est beaucoup dans la plainte, le regret des échecs du passé. Et en même temps, il y a un élan de rage révolutionnaire brut, radical et sans concession. Comme chez Duras finalement.
Nous allons composer une musique à partir des pensées « no future », du thème de la fin du monde, qui sont des postures très présentes dans l’art des années 70/80 et encore aujourd’hui. J’ai envie de pousser la caricature pour opérer un sursaut. Mon désir est qu’au final, on en vienne à sourire, se dire : on souffre, c’est dur mais, malgré tout, c’est beau et passionnant la vie. Pousser la caricature jusqu’à un point où elle devient dérisoire.
Justement, comment voyez-vous la violence politique du texte, l’idée de la mort de l’espoir ? Dans Le Camion, Duras ferme la porte au prolétariat, au communisme, aux mouvements politiques…
M.d.M. : …aux espoirs socialistes, oui. Duras a été très engagée dans tous les combats socialistes et communistes du XXe c’est un hymne à la vie, qui a en lui-même une portée révolutionnaire. c’est un hymne à la vie, qui a en lui-même une portée révolutionnaire. siècle. Quand elle écrit Le Camion en 1977, elle est dans une déception radicale, absolue et définitive.
Avec ce texte, ni plus ni moins, elle annonce la mort du politique. Elle affirme que le politique n’est et ne saura jamais être le véhicule d’une quelconque entreprise éthique ou humaine. Corrompu par définition, il est voué à défendre l’inverse de ce qu’il prétend prôner. Bon… Mais ce que je trouve beau, c’est qu’il ne s’agit pas d’une attaque théorique du politique. La désillusion y est vécue sensiblement, comme une tragédie intime, un drame personnel. C’est un hymne poétique du désenchantement politique. Mais pour moi, Le Camion est tout sauf une œuvre défaitiste. Le camion roule sur les terres de l’humanité saccagée, et pourtant ça reste beau ; « Que de choses à voir… tellement. On est débordés vous ne trouvez pas ? »
Il y a cette femme « déclassée » qui voyage dans le camion et dans sa propre histoire intime et politique, ce chauffeur qui « ne voit plus rien que lui-même » et cet autre qui dort… Peut-on dire que Le Camion raconte l’histoire d’une non-rencontre ? Voire d’un « ratage » ?
M.d.M. : Il y a, d’un côté, cette vieille femme anarchiste – on comprend qu’elle a rêvé à la révolution du prolétariat –, qui fait du stop sur le bord de la route, peut-être sans but particulier ; elle est entièrement dans la vie. Et il y a, d’un autre côté, le camionneur qui est juste dans l’exercice de ses fonctions, transportant de la marchandise d’un point à un autre, parce qu’on le lui a demandé ; il ne sait même pas ce que qu’il y a dans ces cartons.
Au-delà de ce chauffeur, Duras parle de l’être humain au service d’une fonction, dont la seule finalité est sa place sociale, sa paie à la fin du mois, et qui perd de vue sa qualité d’être humain, vivant, participant à un monde en présence d’autres êtres humains.
Dans le texte, voyez-vous les deux hommes comme l’incar-nation d’une société axée sur le « matériel » ? Et d’une révolution rendue impossible en partie par la « responsabilité de la classe ouvrière » dont il est question ?
M.d.M. : Pas seulement. Duras dénonce fortement une forme d’individualisme induite par un système de société – le capitalisme, pour le dire vite – qui aliène et sépare de plus en plus les individus de ce qu’on peut appeler la vie. Face à cela, jusqu’à quel point a-t-on le « choix », individuellement ?
La vieille femme semble détachée de toute appartenance sociale ; elle n’a qu’une valise, et tous les souvenirs de sa vie, les souvenirs de sa capacité à aimer aussi – c’est très important. C’est ce que je trouve très beau : même si le texte peut apparaître comme un écrit de désillusion, de séparation, c’est un hymne à la vie, qui a en lui-même une portée révolutionnaire. Il dit que la révolution n’arrivera pas par le politique, pas par la société, mais qu’il y a la possibilité d’être révolutionnaire dans son regard, dans sa manière de vivre, d’aimer, et par le biais de la poésie. Et la vieille femme ne lâche pas son combat : on peut supposer qu’elle recommencera le lendemain à faire du stop, aller à la rencontre.
Entretien réalisé par Fanny Mentré pour le Théâtre national de Strasbourg.